Le grand retournement
(voir séquence en question)
Que
nous soyons des êtres qui faute d’instincts sommes dotés de technè
(savoir-faire inventés et donc artificiels), c’est ce qu’avait vu depuis
longtemps Aristote. Fixiste cependant, il ne s’est jamais demandé comment un
être naturel pouvait devenir un être d’artifice. C’est ce grand retournement
qu’évoque le beau film de Jean-Jacques Annaud, La guerre du feu. Faite
de créatures presqu’encore animales et pas encore humaines, l’époque dite
préhistorique est, pour l’animhumanité, celle du basculement de l’axe du monde.
Celui-ci est, comme on le sait depuis les Mystères, un phallus et c’est dans la
rotation autour de ce dernier qu’une nouvelle terre tissée de l’union
indissociable d’un corps, d’imaginaire et de mots va apparaître. Ce nouveau
continent c’est, bien entendu, celui de la culture émergeant depuis et en
rupture avec ce qu’on appelle communément la nature. Et rien n’est plus
puissant pour marquer ce passage que de montrer avec le cinéaste, à travers
l’invention d’éros, comment les corps naturels, sans cesser d’être ce qu’ils
sont, deviennent corps humains. Expliquera t’on, enfin, ce passage ? Bien
sûr que non si expliquer c’est réduire. On connaît bien la méthode qui consiste
à décomposer le mouvement pour montrer comment la forme nouvelle s’engendre de
l’accumulation de petites variations invisibles – rien alors de véritablement
neuf, mais une continuité logique pour celui qui a pensé et refait le chemin. A
ce procédé, parfaitement légitime en son champ, Jean-Jacques Annaud oppose les
figures éberluées du héros Naoh et de ses compagnons qui voient pour au moins
la deuxième fois l’univers sortir de ses gonds.


La première fois, on s’en souvient, c’était lorsque
Naoh en quête d’un feu que sa tribu trop primitive ne savait pas créer, voyait
celui-ci émerger des mains expertes de sa nouvelle compagne.


La deuxième fois – et c’est ce sur quoi je vais
m’attarder - c’est lorsque cette dernière, prise (comme il se fait et doit) par derrière et sans chichis, se retourne
et invente l’amour face à face.


On notera en passant que ces deux inventions sont
liées à la chaleur. Et par chaleur, je n’entends pas seulement la chaleur
physique, celle qu’est sensée ressentir un corps sans pensée, réduit au pur
sentir – mais, indissociable de celle-là, l’imaginaire, partagé et rayonnant de
ces corps-ci, d’une coexistence autour du foyer commun. Le feu comme la chaleur
du corps unissent et isolent, ouvrant autour du groupe et des amants, une bulle
protectrice dans et par laquelle le processus d’humanisation va se continuer.
Comment penser ce dernier ? Contre toute analyse segmentée qui ne voit
qu’une parcelle du tout, ce qu’il s’agirait de conjoindre au sein d’une telle
étude ce sont, en vrac : les corps, leur mouvement propre au sein de la
nature et des artefacts matériels qu’ils créent et utilisent ;
l’imaginaire dont il faudrait montrer qu’ouvrant une brèche dans le rapport
animal au monde, il rend possible une ouverture et une créativité inédite qui
transforme radicalement notre rapport au monde ; la nature commune,
partagée, objective et co-produite de cette sphère aussi réelle qu’imaginaire –
l’opposition entre les deux perdant ici son sens - qui, par et par-delà la
séparation des existants, s’engendre du rapport actif de chaque vie à l’autre
et au tout. Ce qu’il s’agirait ainsi de joindre sans pour autant les faire
disparaître ce sont les oppositions communes qui nous permettent de
penser : l’imaginaire et le réel, le corps et l’esprit, la nature et la
culture, le naturel et l’artificiel, moi et les autres, la partie et le tout.
Jugeons-en sur cet exemple bouleversant que je m’étais proposé d’interpréter.
Ce qu’il me faut en effet penser, c’est le passage
de cela (première image ci-dessous) à cela (seconde image) :


Je suggérai, un peu plus haut, qu’une telle pensée
ne pouvait être une explication, si par explication on entend réduction, mais,
bien plutôt une description qui, à l’encontre d’une pensée de type cartésien
visant à nous guérir de l’étonnement conçu comme une maladie infantile de
l’esprit, n’efface pas les traits éberlués de Naoh mais s’y engouffre au
contraire pour tenter de souligner et de développer la rupture et l’ouverture
inédites de mondes inédits dont ils manifestent l’intuition. Car, disais-je
mystérieusement, avec ce retournement d’un corps, événement invisible et anodin
au sein de la grande nature, c’est pourtant l’univers tout entier qui change de
sens et d’axe. Montrons-le.
Première image : des femmes, cul nu, qui
s’abreuvent au ruisseau.  Leur vêtements et leur
langage primitifs indiquent qu’elles sont déjà sorties d’un rapport purement
animal au monde. Quoiqu’on dise, en
effet, aujourd’hui sur l’existence de cultures animales, c’est à dire d’inventions
de pratiques, non innées, transmises dans un groupe - il y a,
cependant, un abîme entre ce qu’on appelle culture animale et la culture
humaine. Si l’on a, certes, bien raison de noter que l’animal n’est nullement
une machine, que parler de « l’animal » est, de plus une abstraction
qui recouvre une logique évolutive multiple au sein de laquelle émerge l’animal
humain, que, sur une certaine branche de cette évolution naît l’intelligence,
soit selon Bergson, la capacité de résoudre des problèmes par l’invention
d’artifices techniques, que ce qu’est précisément l’homme a ainsi ses racines
dans l’évolution même de la nature, qu’on ne saurait donc couper l’humanité de
l’animalité sans s’empêcher de comprendre quoi que ce soit à l’homme… si l’on a
donc raison d’affirmer tout cela, il faut aussi, avec le même Bergson,
souligner les ruptures. Car ce qui naît avec l’humanité c’est la culture
entendue non simplement comme transmission sociale de savoirs sporadiques mais
comme ensemble partagé de significations imaginaires incarnées dans des îlots artificiels
au sein de la grande nature, îlot dont la structure propre rend possible le
déploiement systématique et explosif des inventions – indissociables - du sens
et de la technique. Certes, encore une fois, comme l’avait justement pensé
Uexkull, il y a bien nécessairement quelque chose de cet isolement, de cette
autonomisation d’un monde propre, assimilable à un îlot, dans tout processus
vivant, mais ce qu’il s’agit ici de penser c’est la spécificité du monde propre
humain. C’est, on s’en doute, tout le propos de Jean Jacques Annaud. De façon
tout à fait similaire à Rousseau dans son discours sur l’origine de
l’inégalité parmi les hommes, nous partons de la fiction d’un monde
encore à moitié animal et à moitié humain, et l’on montre comment certains traits
qui sont encore animaux en viennent à entrer dans la logique inédite de
l’invention, de l’imaginaire et du sens. Certes alors, on est sûr que l’on va
déconner – en prêtant à ces animhumains des logiques tantôt trop humaines,
tantôt trop animales. Mais c’est qu’on ne peut de toute façon faire
autrement : nous sommes dans un entre-deux incompréhensible, nous situant
dans une phase de transition qui est celle de mutations qualitatives
irréductibles à un simple changement de position des corps. D’un côté, en
effet, nous avons des bestioles qui se sentent le trou du cul et, pour
l’immense majorité, en période fixe de rut, se sautent les unes sur les autres
rapidement, pour soi-même et sans chichis ou avec les petits chichis qui, pour
l’essentiel, sont ceux, quasi-éternels, de leur espèce. De l’autre, on le
verra, une érotisation indissociable de significations imaginaires, une
érogénéisation quasi-totale des corps qui deviennent tendanciellement en la
moindre parcelle de chair support de fantasme, une bulle relationnelle, enfin,
où s’ébrouent deux corps, deux regards et deux imaginaires qui sont bien
davantage que la somme des deux. Comment se fait donc le passage ? Il se
fait, nous en sommes certains si l’homme est, ainsi que je le crois, un produit
de la nature – mais, je suis tout aussi sûr de ne pouvoir le comprendre. Au
moins, peut-on le décrire, et c’est - je n’arrête pas de le dire – tout
l’apport de ce grand film. Allons-y donc enfin !
Leur vêtements et leur
langage primitifs indiquent qu’elles sont déjà sorties d’un rapport purement
animal au monde. Quoiqu’on dise, en
effet, aujourd’hui sur l’existence de cultures animales, c’est à dire d’inventions
de pratiques, non innées, transmises dans un groupe - il y a,
cependant, un abîme entre ce qu’on appelle culture animale et la culture
humaine. Si l’on a, certes, bien raison de noter que l’animal n’est nullement
une machine, que parler de « l’animal » est, de plus une abstraction
qui recouvre une logique évolutive multiple au sein de laquelle émerge l’animal
humain, que, sur une certaine branche de cette évolution naît l’intelligence,
soit selon Bergson, la capacité de résoudre des problèmes par l’invention
d’artifices techniques, que ce qu’est précisément l’homme a ainsi ses racines
dans l’évolution même de la nature, qu’on ne saurait donc couper l’humanité de
l’animalité sans s’empêcher de comprendre quoi que ce soit à l’homme… si l’on a
donc raison d’affirmer tout cela, il faut aussi, avec le même Bergson,
souligner les ruptures. Car ce qui naît avec l’humanité c’est la culture
entendue non simplement comme transmission sociale de savoirs sporadiques mais
comme ensemble partagé de significations imaginaires incarnées dans des îlots artificiels
au sein de la grande nature, îlot dont la structure propre rend possible le
déploiement systématique et explosif des inventions – indissociables - du sens
et de la technique. Certes, encore une fois, comme l’avait justement pensé
Uexkull, il y a bien nécessairement quelque chose de cet isolement, de cette
autonomisation d’un monde propre, assimilable à un îlot, dans tout processus
vivant, mais ce qu’il s’agit ici de penser c’est la spécificité du monde propre
humain. C’est, on s’en doute, tout le propos de Jean Jacques Annaud. De façon
tout à fait similaire à Rousseau dans son discours sur l’origine de
l’inégalité parmi les hommes, nous partons de la fiction d’un monde
encore à moitié animal et à moitié humain, et l’on montre comment certains traits
qui sont encore animaux en viennent à entrer dans la logique inédite de
l’invention, de l’imaginaire et du sens. Certes alors, on est sûr que l’on va
déconner – en prêtant à ces animhumains des logiques tantôt trop humaines,
tantôt trop animales. Mais c’est qu’on ne peut de toute façon faire
autrement : nous sommes dans un entre-deux incompréhensible, nous situant
dans une phase de transition qui est celle de mutations qualitatives
irréductibles à un simple changement de position des corps. D’un côté, en
effet, nous avons des bestioles qui se sentent le trou du cul et, pour
l’immense majorité, en période fixe de rut, se sautent les unes sur les autres
rapidement, pour soi-même et sans chichis ou avec les petits chichis qui, pour
l’essentiel, sont ceux, quasi-éternels, de leur espèce. De l’autre, on le
verra, une érotisation indissociable de significations imaginaires, une
érogénéisation quasi-totale des corps qui deviennent tendanciellement en la
moindre parcelle de chair support de fantasme, une bulle relationnelle, enfin,
où s’ébrouent deux corps, deux regards et deux imaginaires qui sont bien
davantage que la somme des deux. Comment se fait donc le passage ? Il se
fait, nous en sommes certains si l’homme est, ainsi que je le crois, un produit
de la nature – mais, je suis tout aussi sûr de ne pouvoir le comprendre. Au
moins, peut-on le décrire, et c’est - je n’arrête pas de le dire – tout
l’apport de ce grand film. Allons-y donc enfin !
Donc, disais-je, des femmes cul nu qui s’abreuvent
sans grande délicatesse à l’eau d’un ruisseau. Un peu plus loin derrière, un
homme du clan qui, attiré par la vue des derrières, en  prend une au hasard, là
encore par derrière, éjacule puis se barre sous le regard à moitié vide et
cependant apeuré des autres femmes qui, visiblement, n’aiment pas trop ça mais
bon. Nous sommes vers le début du film et donc, par hypothèse, très proche de
l’animalité. Et, en effet, c’est bien ce qu’il semble se passer chez nos amis
canins ou chez les chimpanzés (moyennant quelques chichis, il est
vrai, « mais bon »,disais-je profondément un tout petit peu plus
haut). A vrai dire ici, la métaphysique de l’amour de Schopenhauer
fonctionne merveilleusement bien pour expliquer le mécanisme - là où elle
échouera à expliquer ce que j’appelle le grand retournement. Ce qui pousse, en
effet, ce primate échaudé c’est la quête d’un plaisir égoïste et solitaire dont
l’objet se trouve être justement dans la fente présentée par ce cul qui se
baisse. Quel hasard ! Cela aurait pu être un tronc d’arbre, sa propre
main, un éléphant... Mais ce n’en est évidemment pas un car, dit Schopenhauer,
à travers le désir de cet homme, l’embrasement de tous ses sens qui lui fait
perdre le peu de raison qu’il avait, c’est, tout comme chez les bêtes, l’espèce
qui travaille et le manipule cherchant par le biais de son individualité à se
reproduire : avec un éléphant l’espèce se serait éteinte (ce qui, dans un
modèle darwinien, tissé de mutations au
hasard, donc sans finalité, a bien pu se produire : il y aurait eu des
hommes amoureux d’éléphants – mais ils ont disparu). Rien donc ici encore que
d’animal : pas ou peu de chichis, plaisir égoïste, rapidité de l’acte,
position unique sans inventivité, objet de désir déterminé et univoque,
indifférence relative à (et, ici, de) la compagne, réaction à une pulsion qui
naît spontanément du travail de l’espèce en nous...
prend une au hasard, là
encore par derrière, éjacule puis se barre sous le regard à moitié vide et
cependant apeuré des autres femmes qui, visiblement, n’aiment pas trop ça mais
bon. Nous sommes vers le début du film et donc, par hypothèse, très proche de
l’animalité. Et, en effet, c’est bien ce qu’il semble se passer chez nos amis
canins ou chez les chimpanzés (moyennant quelques chichis, il est
vrai, « mais bon »,disais-je profondément un tout petit peu plus
haut). A vrai dire ici, la métaphysique de l’amour de Schopenhauer
fonctionne merveilleusement bien pour expliquer le mécanisme - là où elle
échouera à expliquer ce que j’appelle le grand retournement. Ce qui pousse, en
effet, ce primate échaudé c’est la quête d’un plaisir égoïste et solitaire dont
l’objet se trouve être justement dans la fente présentée par ce cul qui se
baisse. Quel hasard ! Cela aurait pu être un tronc d’arbre, sa propre
main, un éléphant... Mais ce n’en est évidemment pas un car, dit Schopenhauer,
à travers le désir de cet homme, l’embrasement de tous ses sens qui lui fait
perdre le peu de raison qu’il avait, c’est, tout comme chez les bêtes, l’espèce
qui travaille et le manipule cherchant par le biais de son individualité à se
reproduire : avec un éléphant l’espèce se serait éteinte (ce qui, dans un
modèle darwinien, tissé de mutations au
hasard, donc sans finalité, a bien pu se produire : il y aurait eu des
hommes amoureux d’éléphants – mais ils ont disparu). Rien donc ici encore que
d’animal : pas ou peu de chichis, plaisir égoïste, rapidité de l’acte,
position unique sans inventivité, objet de désir déterminé et univoque,
indifférence relative à (et, ici, de) la compagne, réaction à une pulsion qui
naît spontanément du travail de l’espèce en nous...
C’est à travers ce modèle là que, dans les débuts du
film, Naoh se promène. Pris par un désir subit, il viole sauvagement Ika, sa
nouvelle compagne. Peut-on d’ailleurs parler de viol ? Là  encore rien n’est simple
puisque l’on ne sait pas trop à qui l’on a affaire : encore des animaux ou
déjà des hommes ? Quand il n’y a pas d’autres possibles, donc pas de
liberté, Ika serait-elle mécontente, ne faut-il pas parler de simple copulation
sans plaisir réciproque ? Mais il y a des autres possibles puisqu’autre
chose va – et peut donc - arriver ! Mais non ! répondra un
bergsonien, cela ne devient possible qu’après coup, le possible posé au
préalable étant une illusion rétrospective. Cela se complique cependant un peu,
puisque Ika vient d’une tribu plus civilisée et donc, semble t’il, plus avancée
sur le chemin de la liberté. Si un gorille viole un juge ou une jouvencelle,
ces derniers se considèrent comme violés mais le singe, lui, est innocent et
n’est pas un violeur. Passons : ce qui est, cependant, plus certain c’est
qu’à la fin du film, un Naoh qui sauterait sur Ika sans lui demander la
permission serait désormais bien davantage du côté des violeurs que de ces pauvres
et innocents gorilles. Quoi qu’il en soit, au cours de leur aventure, les
choses changent peu à peu : des relations de protection, de douceur et
d’échange se nouent entre Naoh et Ika. Que se passe t’il, par exemple, dans la
tête de Naoh lorsqu’Ika le soigne de ses blessures en lui faisant ce qui
ressemble à une petite turlute ? Dans son regard à nouveau quelque peu
interloqué nous lisons un mélange de douleur, de plaisir et d’étonnement, à
travers lesquels un imaginaire clos semble se fissurer.
encore rien n’est simple
puisque l’on ne sait pas trop à qui l’on a affaire : encore des animaux ou
déjà des hommes ? Quand il n’y a pas d’autres possibles, donc pas de
liberté, Ika serait-elle mécontente, ne faut-il pas parler de simple copulation
sans plaisir réciproque ? Mais il y a des autres possibles puisqu’autre
chose va – et peut donc - arriver ! Mais non ! répondra un
bergsonien, cela ne devient possible qu’après coup, le possible posé au
préalable étant une illusion rétrospective. Cela se complique cependant un peu,
puisque Ika vient d’une tribu plus civilisée et donc, semble t’il, plus avancée
sur le chemin de la liberté. Si un gorille viole un juge ou une jouvencelle,
ces derniers se considèrent comme violés mais le singe, lui, est innocent et
n’est pas un violeur. Passons : ce qui est, cependant, plus certain c’est
qu’à la fin du film, un Naoh qui sauterait sur Ika sans lui demander la
permission serait désormais bien davantage du côté des violeurs que de ces pauvres
et innocents gorilles. Quoi qu’il en soit, au cours de leur aventure, les
choses changent peu à peu : des relations de protection, de douceur et
d’échange se nouent entre Naoh et Ika. Que se passe t’il, par exemple, dans la
tête de Naoh lorsqu’Ika le soigne de ses blessures en lui faisant ce qui
ressemble à une petite turlute ? Dans son regard à nouveau quelque peu
interloqué nous lisons un mélange de douleur, de plaisir et d’étonnement, à
travers lesquels un imaginaire clos semble se fissurer.


Amoukar, la brute sympathique, en une image pleine
de subtilité, en  perdra sa courgette. Je
n’insiste pas là-dessus, quoiqu’il y ait sûrement beaucoup à dire tant sur
l’invention de l’érotisme comme rupture de la courge que sur la formation du
cocon humain qui, comme Sloterdjick, après moi, l’a souligné, est la condition
et l’effet en retour de l’humanisation. Que la formation d’un tel cocon s’étaye
à son tour (ce terme, sur l’importance duquel insiste Castoriadis, marque
l’existence de ce qui peut parfois être une condition de possibilité sans être
cependant une cause ou une raison suffisante) sur le développement d’une
logique affective de l’attachement, de la compassion et de la douceur qui se
déploie tendanciellement dans le règne mammifère, c’est aussi évident : il
faudrait montrer que la naissance de l’anthroposphère ou de quelque chose qui
lui ressemble n’était pas possible chez les insectes ou les reptiles. On
trouvera chez E. Morin dans Le paradigme perdu quelques éléments en ce
sens encore bien actuels. Mais ce n’est pas ce qui m’intéresse ici : si je
cessais un peu de m’interrompre, j’en viendrais enfin au fait qui est le
grand retournement, au lieu de le dissoudre dans ce qui, pour le préparer,
ne l’explique cependant aucunement.
perdra sa courgette. Je
n’insiste pas là-dessus, quoiqu’il y ait sûrement beaucoup à dire tant sur
l’invention de l’érotisme comme rupture de la courge que sur la formation du
cocon humain qui, comme Sloterdjick, après moi, l’a souligné, est la condition
et l’effet en retour de l’humanisation. Que la formation d’un tel cocon s’étaye
à son tour (ce terme, sur l’importance duquel insiste Castoriadis, marque
l’existence de ce qui peut parfois être une condition de possibilité sans être
cependant une cause ou une raison suffisante) sur le développement d’une
logique affective de l’attachement, de la compassion et de la douceur qui se
déploie tendanciellement dans le règne mammifère, c’est aussi évident : il
faudrait montrer que la naissance de l’anthroposphère ou de quelque chose qui
lui ressemble n’était pas possible chez les insectes ou les reptiles. On
trouvera chez E. Morin dans Le paradigme perdu quelques éléments en ce
sens encore bien actuels. Mais ce n’est pas ce qui m’intéresse ici : si je
cessais un peu de m’interrompre, j’en viendrais enfin au fait qui est le
grand retournement, au lieu de le dissoudre dans ce qui, pour le préparer,
ne l’explique cependant aucunement.
Voilà donc le centre de ma discussion, ce moment de
rien du tout, à peine visible sur mon image, même largement agrandie – ce que
j’interprète librement comme une intention de l’auteur cachant dans la pénombre
l’intimité conquise (à moins que cela soit dû à la qualité médiocre de mon
logiciel de lecture…) :
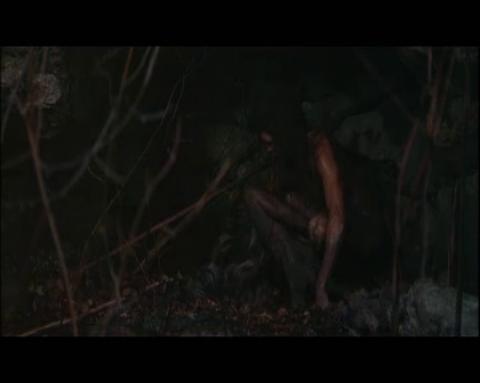
Oui, Ika se retourne ! Rien d’étonnant pour
nous qui sommes habitués aux quadri rotations à double vitesse version latex et
costume romain. Aussi, disait Lucrèce en un autre contexte, ne regardons-nous
plus le ciel étoilé qui, nous apparaîtrait-il pour la première fois, serait
cependant une source d’intense émerveillement. C’est, tout au contraire, à ce
regard originaire, celui même, éberlué, de Naoh, que la fiction du primitif
nous renvoie ici, brisant ainsi le sol figé de nos habitudes et de nos schémas
de perception du monde. De quoi - si j’ose dire - retourne t’il, en
effet ?
Je fantasme la scène : jusqu’ici il y avait
deux corps, deux désirs, deux chaleurs – deux êtres séparés, attirés l’un vers l’autre
par une force impersonnelle qui, d’un seul coup, ils ne savaient pourquoi,
embrasait leur corps et dirigeait chacun vers le sexe de l’autre. Puis les
gestes éternels, sédiment en leur corps du passé de l’espèce. Et le plaisir
enfin, feu bref préludant à la séparation et à l’indifférence. Ainsi qu’il en
était depuis les origines, deux corps s’étaient perçus, désirés et rejoint,
étaient rentrés en transe, puis s’étaient séparés. Comme toujours. Que
s’était-il passé ? Rien. Rien de nouveau sous la lune pâle : la
nature continuait son œuvre en fécondant les ventres comme elle fait à la
terre.
Or voilà qu’au sein de la torpeur ivre des corps
mélangés quelque chose s’éveille, quelque chose se brise. Ika n’en peut plus de
désir. Son corps se tord : être ici, pleinement ici, s’échapper, être ici,
s’ancrer dans la chaleur qui enflamme son ventre. Où, où aller ? -
plus loin, toujours plus profond dans un plaisir inouï que son corps embrasé
touche sans cependant jamais en pénétrer le cœur. Ici, ailleurs : dans les
bras, dans les yeux de Naoh, tout contre la poitrine qu’elle sent derrière elle
- oui le voir et l’enserrer dans ses bras enflammés ! Et Ika se retourne.
Le balancier du temps d’un seul coup se détraque. Ika vient de briser les
gestes éternels. Les yeux de Naoh s’ouvrent, stupéfaits. Ils s’ouvrent sur Ika
en transe de plaisir. Il la voit : elle est belle, fascinante. Et il est à
son tour transi de désir, d’un désir obscur, inédit et intense qui traverse sa chair et sort de son
être pour s’enfouir en Ika. Il la sert davantage, il la cherche, il la mord. Il
invente à son tour (et moi aussi d’ailleurs). Un monde vient de naître : nous-deux
vient d’apparaître, la sphère d’éros, de l’amour charnel, les enveloppe
désormais,
« ouvrant dans la
nature un nouvel espace-temps
pour l’imagination folle des
corps désirants »
(Casimir Bucolic).
Cette étreinte là n’est pas terminée. Elle traverse
les temps. Le désir qui la tend, la tension ivre qu’elle inaugure ouvre à la
nouvelle érosphère un avenir de gestes, de caresses et de mots proprement
infinis. Il faut lire l’histoire de l’amour comme une tension croissante qui
traverse les êtres et se dépose en gestes, en nouvelles caresses, en mots
tendres ou cruels, en rites amoureux, en mondes érotiques, inventés un beau
jour par le corps désirant et imaginant des amants de tous temps. Ce qu’il me
plaît de voir tout autant qu’inventer c’est que ces mille façons d’aimer, ces
mille mondes de sens ô combien incarné sont contenus en germe dans ce moment de
rien à l’échelle de l’être, lorsque qu’Ika se retourne. Dans le retournement
d’Ika, c’est le corps animal qui devient érotique ; c’est le geste éternel
qui devient inventif ; c’est le corps d’une sphère faite de deux désirs
qui d’un seul coup se forme. Et se ferme en ouvrant l’espace infini de mondes
imaginaires autour de l’être-à-deux.
Ce que j’aime à y voir c’est la réalité d’une
tension créatrice qui déploie une histoire. Ainsi peut-on lire dans les
ricochets de l’enfant, qui sont, selon Hegel, un désir de marquer le monde
étranger du sceau de notre esprit et de notre puissance, le développement en
ondes des civilisations comme l’histoire supposée d’une appropriation et d’une
maîtrise du monde. En un raccourci tout aussi saisissant, dans le premier
outil, Kubrick lit, à son tour, toute l’aventure technique : l’arme jetée
dans le ciel par l’ancêtre primitif devient une navette condensant en son être
le temps long d’une quête.




On peut lire sur ce thème l’histoire de l’amour
comme une longue symphonie, ouverte sur des mondes à nos corps inconnus, dont
la caresse d’Ika est la première mesure. Certes la musique, de temps en temps
dérape. Elle hésite, elle s’arrête parfois. Elle se fige en rites, se casse la
gueule parfois en « tu aimes ça salope ! » et autres
mots courtois. Mais ce qu’on sait aussi c’est qu’au sein des millions de
millions d’érosphères continue à brûler la flamme allumée, un jour, par Ika. En
l’un de ses foyers, d’un seul coup elle s’emballe et embrase les désirs leur
faisant inventer une danse inédite faite de corps et de mots qui dans leur
tournoiement dessinent l’espace clos d’une voûte étoilée pour un nouvel amour.
Que maintenant, après tout cela, le film soit peu
compatible avec les données des préhistoriens actuels, qu’il se trompe sur bien
des points, c’est ce que souligne à propos l’auteur de l’article La guerre
du feu sur wikipédia.
On n’en conclura pas cependant, comme semble le faire ce dernier, qu’il faut l’éliminer
de toute prétention à la vérité et le ramener au pur jeu gratuit de la
fiction : comme toutes les grandes œuvres, et souvent bien mieux que les
discours qui se prévalent de la science, à travers un récit inventé, il donne à
sentir et penser la profondeur d’une immense vérité. Peu importe à vrai dire,
et pour l’essentiel ici, l’inexactitude du quoi, du quand et du comment. Ce qui
importe par-dessus tout c’est la mise en lumière du grand retournement
qui, d’une manière ou d’une autre, en un temps ou un autre, a fait un jour
sortir la nature de ses gonds.
Alex Taget